Pour accéder aux questions d'une sous-thématique en particulier, veuillez cliquer sur l'un des boutons ci-dessous :
Créer et gérer mon entreprise
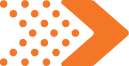
Créer et pérenniser mon entreprise
Depuis le 14 septembre 2024, la loi n°du 13 juin 2024 modernise en profondeur les règles de gouvernance des sociétés françaises. Elle introduit de nouvelles possibilités de décision à distance, favorise la dématérialisation des assemblées générales et assouplit certaines procédures internes. Il est important de vérifier si vos statuts sont en phase avec ces nouvelles dispositions.
Principales évolutions pour les sociétés anonymes (SA)
Consultation écrite facilitée
Toutes les décisions du conseil d’administration peuvent désormais être prises par écrit, sauf si les statuts l’interdisent expressément. Le vote par correspondance devient également possible pour les administrateurs, sous réserve d’une clause statutaire. Ces consultations peuvent se faire par voie électronique.
Réunions à distance généralisées
Les réunions du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent avoir lieu par visioconférence, téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, sans formalité complexe. Cette mesure est désormais la norme.
Assemblées générales modernisées
Il est possible d’organiser une assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire) en présentiel, à distance ou en mode hybride, sans obligation de modifier les statuts. Le seuil de contestation d’une assemblée générale extraordinaire tenue à distance passe de 5 % à 25 % du capital social.
SA à conseil de surveillance et directoire
Le conseil de surveillance peut désormais nommer plusieurs vice-présidents pour assurer la continuité des réunions. Un décret encadre également certaines décisions financières du directoire.
Ce qui change pour les SARL, SC, SNC et autres formes sociales
Consultation électronique élargie
Les associés peuvent approuver les comptes par consultation écrite, y compris par voie électronique, si les statuts le permettent. Cette mesure s’applique aussi aux sociétés civiles (SC), sociétés en nom collectif (SNC) et sociétés en commandite simple (SCS), avec adaptation statutaire.
Réunions à distance facilitées
La tenue des assemblées générales à distance est désormais plus simple et autorisée par défaut dans plusieurs cas, à condition que les statuts soient compatibles.
Cas spécifique des SAS
Les sociétés par actions simplifiées (SAS) ne sont pas concernées par cette réforme. Elles conservent leur liberté statutaire : toute possibilité de consultation écrite ou de réunion à distance doit être prévue dans les statuts.
Attention à l’adaptation des statuts
Pour tirer pleinement parti de ces nouvelles possibilités, les entreprises doivent s’assurer que leurs statuts autorisent les modalités électroniques de consultation, de vote ou de réunion, sauf pour certaines règles propres aux SA qui s’appliquent d’office.
Même si une société en formation n’a pas de personnalité juridique, ses représentants peuvent conclure des actes pour préparer l’activité future de la société.
Jusqu’au 29 novembre 2023, pour qu’un acte passé par une société en cours de formation soit repris, il devait mentionner la formule suivante : « acte passé au nom et/ou pour le compte de la société X en formation ».
Depuis le 29 novembre 2023, et les trois arrêts rendus par la Cour de cassation, ce formalisme a été assoupli : il n’est plus nécessaire de mentionner la formule « l’acte passé au nom et/ou pour le compte de la société » mais de prouver, par tout moyen, que la commune intention des parties était de conclure l’acte concerné.
Ce revirement de jurisprudence permet non seulement de limiter le risque de nullité de certains actes conclus par les parties souhaitant leurs conclusions, mais il va également limiter le risque d'utilisation de ce motif pour que d’autres parties se soustraient de leurs propres engagements.
Au moment de créer sa société, chaque porteur de projet se demande quel nom doit-il choisir. Même si ce choix est libre, certaines vérifications préalables ne doivent pas être négligées. Aussi et afin d'éviter toute poursuite éventuelle, voici quelques bonnes pratiques :
1. Une recherche préalable de disponibilité
Se renseigner si le nom souhaité n’est pas déjà utilisé par une autre entreprise exerçant une activité identique ou similaire. Si vous négligez cette recherche, la société qui porte déjà un nom similaire à votre société pourra vous poursuivre en concurrence déloyale notamment pour détournement de la clientèle. Pour ce faire, rendez-vous sur le site de l’INPI, rubrique « Disponibilité marque, société et nom de domaine ».
2. Un contrôle de forme
Peu importe que le nom ait un sens ou n’en ait pas, il faut privilégier une dénomination composée uniquement des signes alphanumériques (lettres ainsi que les chiffres romains ou arabes). En effet, à plusieurs reprises, l’emploi des singes particuliers tels que les « # », « / », « * » a déjà été refusé.
3. Un contrôle de fond
Il est important de se rappeler que la dénomination choisie devra être validée par un agent de justice (le Greffier lors du dépôt de vos statuts) : celui-ci va donc vérifier si le nom choisi ne contrevient pas à l’ordre public ni aux bonnes mœurs.
Depuis la loi « 3DS » de février 2022, toutes les communes doivent nommer et numéroter leurs voies et lieux-dits. Cela peut entraîner un changement de libellé de l’adresse de votre société, différent d’un transfert de siège social.
Comment ça se passe concrètement ?
- Mise à jour automatique par le greffe : si le greffier reçoit l’information de l’administration, l’adresse est modifiée d’office dans le RCS, gratuitement. La société pourra ensuite être invitée à déposer ses statuts mis à jour.
- Mise à jour à l’initiative de la société : si vous demandez vous-même la modification sur le guichet unique, cela constitue une formalité d’entreprise, avec émoluments et débours. Actuellement, cette demande n’ouvre pas droit à la gratuité.
Bonne nouvelle : ce changement administratif n’est pas soumis à frais de déclaration lorsqu’il est signalé directement par l’administration au greffe.
Avant toute modification, pensez donc à vous informer auprès de votre mairie pour savoir si le changement de libellé sera communiqué au greffe.
Notez qu’un projet de décret est en cours pour garantir la gratuité ou limiter les frais lorsque la société effectue elle-même la demande.
Source : question écrite n°5216
À NOTER
En cas de changement d’activité, pensez également à modifier l’objet social de votre société !
Les entreprises de propreté relèvent principalement de la division 81 - SERVICES RELATIFS AUX BÂTIMENTS ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER comprenant notamment :
- 81.2 SERVICES DE NETTOYAGE : les activités de nettoyage intérieur et extérieur des bâtiments, les activités de nettoyage spécialisé de bâtiments et les autres activités de nettoyage spécialisé, nettoyage de machines industrielle, etc.
- Classe : 81.21 NETTOYAGE COURANT DE BATIMENTS
- Sous-classe : 81.21 Z NETTOYAGE COURANT DES BATIMENTS : ces activités comprennent principalement le nettoyage intérieur, même si elles peuvent inclure le nettoyage des espaces extérieurs associés tels que les vitres ou les couloirs. Cette sous-classe comprend : le nettoyage courant (non spécialisé) de tous types de bâtiments tels que les bureaux.
- Classe : 81.22 AUTRES ACTIVITES DE NETTOYAGE DES BATIMENTS ET NETTOYAGE INDUSTRIEL
- Sous classe : 81.22 Z AUTRES ACTIVITES DE NETTOYAGE DES BATIMENTS ET NETTOYAGE :
- le nettoyage extérieur de bâtiments de tous types, y compris les bureaux, les usines, les magasins, les locaux d'institutions, les autres locaux à usage commercial et professionnel et les immeubles à appartements,
- les activités de nettoyage spécialisé de bâtiments, telles que le nettoyage des vitres, le ramonage des cheminées et le nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs, des chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs d'évacuation des fumées,
- le nettoyage de machines industrielles,
- les autres activités de nettoyage des bâtiments et de nettoyage industriel n.c.a.
- Sous classe : 81.22 Z AUTRES ACTIVITES DE NETTOYAGE DES BATIMENTS ET NETTOYAGE :
- Classe : 81.29 AUTRES ACTIVITES DE NETTOYAGE
- Sous classe : 81.29A Désinfection, désinsectisation, dératisation
- Sous classe : 81.29B Autres activités de nettoyage
- Classe : 81.21 NETTOYAGE COURANT DE BATIMENTS
Si votre structure n’a qu’une activité, la question de l’attribution du code APE ne se pose pas.
En revanche, en cas d’activités multiples, l’activité principale sera celle dont le chiffre d’affaires ou les effectifs sont les plus élevés.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi Pacte, le domaine des annonces légales a connu de nombreuses évolutions. Comme l’année passée, l’arrêté du 16 décembre 2024 vient modifier l’arrêté du 19 novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales.
Découvrez ci-après les nouveaux tarifs :
- 0,237 € à Paris et dans les départements franciliens de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne),
- 0,225 € dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais dans les Yvelines, le Val-d’Oise, la Seine-et-Marne et l’Essonne,
- 0,204 € dans l’Eure et la Seine-Maritime,
- 0,193 € dans l’Aisne, l’Oise, la Somme, l’Ardèche, les Ardennes, la Drôme, l’Isère, le Rhône et l’Yonne,
- 0,208 € à la Réunion et à Mayotte,
- 0,183 € en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et à Wallis-et-Futuna,
- 0,187 € dans les autres départements.
Les tarifs forfaitaires connaissent également une légère évolution. Pour rappel, le tarif forfaitaire dépend de la forme de la société et de la procédure mise en place.
Pour 2025, les tarifs au forfait sont les suivants :
| Forme de la société | Tarif applicable à la Réunion et à Mayotte | Tarif applicable dans les départements (sauf la Réunion et Mayotte) |
| Société anonyme (SA) | 462 € | 395 € |
| Société par actions simplifiée (SAS) | 231 € | 197 € |
| Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) | 165 € | 141 € |
| Société en nom collectif (SNC) | 257 € | 218 € |
| Société à responsabilité limitée (SARL) | 171 € | 147 € |
| Société à responsabilité unipersonnelle (EURL) | 146 € | 123 € |
| Société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) | 260 € | 220 € |
| Société civile immobilière (SCI) | 221 € | 189 € |
| Forme de la société | Tarif applicable à la Réunion et à Mayotte | Tarif applicable dans les départements (sauf la Réunion et Mayotte) |
| Acte de nomination des liquidateurs | 179 € | 152 € |
| Avis de clôture de la liquidation | 182 € | 110 € |
| Annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives | 77 € | 65 € |
| Annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives | 42 € | 36 € |
Depuis le 16 octobre 2023, le dépôt de formulaires papier n'est plus accepté, sauf pour :
- les modifications ou cessations d’entreprises étrangères,
- les créations d’associations immatriculées au RCS.
Aussi, vous devez réaliser l’ensemble des démarches sur le site du Guichet unique. Un tableau résumant les modalités de dépôt possibles selon les types de formalités a été mis en ligne dans la FAQ du guichet unique.
De sa création à son développement, la vie de votre entreprise sera rythmée par vos prises de décisions juridiques qui peuvent donner lieu à la modification de ses statuts. Dans ce cadre, vous devrez respecter une procédure stricte prévue par l'administration.
Les statuts déposés lors de la création de votre société comprennent un certain nombre d’informations obligatoires qui permettent de définir la nature de votre activité et ses moyens de fonctionnement :
- sa dénomination sociale,
- sa forme juridique,
- l'adresse de son siège social,
- les apports de chaque associé ou actionnaire,
- le montant du capital social,
- l'objet c'est à dire la synthèse des activités principales de la société,
- sa durée de vie.
A cela, s’ajoutent des informations complémentaires telles que :
- les règles de prise de décision des principaux organes de la société,
- la répartition des parts sociales entre les associés,
- la désignation du gérant, président, directeur général, etc…
Pour effectuer la modification des statuts de votre société tout dépendra de sa forme juridique et de la nature des modifications que vous souhaitez faire. Souvent, ces modalités requièrent un accord unanime des associés ou des actionnaires pour acter la décision, en voici quelques exemples :
- SARL créée après le 4 août 2005 : Majorité des 2/3 des parts sociales des associés présents
- Société anonyme (SA) : Quorum de 2/3 des voix des actionnaires présents. Unanimité requise pour l’augmentation de leur engagement ou le changement de nationalité de la société
- Société en nom collectif (SNC) : Unanimité requise
- Société par actions simplifiée (SAS) : Conditions de modifications spécifiées dans les statuts
- Société civile : Conditions de modifications spécifiées dans les statuts, à défaut, l’unanimité est requise
En fonction du changement apporté à vos statuts, vous devrez accomplir des démarches administratives telles que :
- la publication d’une annonce légale,
- l'inscription du changement au registre du commerce et des sociétés (RCS) et/ou dépôt au greffe du tribunal de commerce,
- la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc).
Oui. Même si la Cour de cassation n’exige pas de résolution distincte, lorsqu’une SARL envisage sa transformation en SAS, l’approbation du rapport sur la valeur des biens doit être expresse, sous peine de nullité de la transformation.
Pour ce faire, il convient de désigner un commissaire à la transformation chargé d’évaluer les biens de l’actif social et de mentionner explicitement son rapport dans la résolution de transformation.
Pensez donc à prévoir une clause de non-concurrence au sein de vos actes statutaires !
Il est parfaitement possible et fortement recommandé d’insérer dans les statuts des clauses destinées à régir le transfert des actions à des tiers.
Ainsi, il est possible de prévoir que le transfert sera subordonné à l’agrément préalable des associés (selon des conditions de majorité à définir) et/ou encore que le transfert ne pourra intervenir valablement qu’à défaut d’exercice par les autres associés de leur droit de préemption.
De telles clauses doivent être prévues statutairement ou, s’il y a lieu, aux termes d’un pacte d’associés.
Les informations structurelles et événementielles d'une entreprise sont des ressources clés pour vérifier sa solvabilité. Voici comment les trouver :
1. Comment se renseigner sur l'existence juridique d'une entreprise ?
Sirene
L'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) met à disposition deux outils permettant d'accéder aux informations officielles sur la situation d'entreprises :
La plateforme avis-situation-sirene.insee.fr permet de générer les avis de situations d'un établissement.
La base sirene.fr est en partie alimentée par les informations transmises à l'Insee par les centres de formalités des entreprises suite aux démarches obligatoires que doivent effectuer les sociétés. Ainsi, sirene.fr regroupe les immatriculations, radiations et modifications au répertoire des entreprises. Elle permet aussi de créer des listes d'établissements par critère afin de les comparer.
Infogreffe
Le site Infogreffe permet de consulter gratuitement le statut et les actes d'une entreprise, ainsi que ses chiffres clés. D'autres ressources payantes peuvent être commandées, comme : l'extrait kbis, l'inscription de privilèges et de nantissements, les comptes annuels détaillés et l'historique des événements significatifs.
Répertoire national des métiers
Le registre public des entreprises artisanales tenu par les chambres de métiers et de l’artisanat, regroupe les entreprises artisanales enregistrées au Répertoire des métiers. On peut y trouver notamment les dates d'immatriculation ou de radiation.
L’Annuaire des Entreprises
La plateforme annuaire-entreprises.data.gouv.fr regroupe des données ouvertes issues de la base Sirene de l'Insee, du Registre national du commerce et des sociétés (RNCS) et du Répertoire national des métiers (RNM).
2. Où trouver les publications légales d'une entreprise ?
Info-financière
Le site Info-financière.fr répertorie les informations réglementées concernant la vie des entreprises cotées en Bourse : rapports financiers, informations boursières et actionnariales, etc. Les informations proposées sont issues des ressources de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
AMF - Autorité des marchés financiers
L'AMF peut sanctionner les sociétés qui auraient des pratiques contraires aux lois et règlements de son champ de compétence. L'ensemble des décisions de la commission de sanction de l'AMF est disponible sur son site.
Bodacc - Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
Le Bodacc contient certaines annonces officielles concernant les entreprises, les associations ou les marchés publics. Plus précisément, il publie les actes enregistrés au registre du commerce (depuis le 1er janvier 2008), les ventes et cessions, les immatriculations, les créations d'établissements, les modifications et radiations de personnes physiques ou morales inscrites au registre du commerce et des sociétés, les procédures collectives et les avis de dépôt des comptes des sociétés.
Aussi, la plateforme permet de créer des alertes pour suivre les nouvelles ressources disponibles concernant une entreprise.
PPLE - Portail de la publicité légale des entreprises
La plateforme pple.fr s'appuie sur les jeux de données de l'Insee pour regrouper les publications du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales Bodacc , les inscriptions et documents enregistrés et déposés aux registres du commerce et des sociétés disponibles sur le site Infogreffe et les annonces publiées dans les journaux d’annonces légales et consultables sur la plateforme Actulégales.
Balo - Bulletin des annonces légales obligatoires
La page Balo du site du Journal officiel contient les annonces des entreprises qui ont fait publiquement appel à l'épargne et aux établissements bancaires et financiers. La page Balo permet de trouver les opérations financières, les avis de convocation aux assemblées générales, les comptes annuels d'entreprises.
Data INPI
L’INPI (Institut national de la propriété industrielle) centralise tous les comptes de SA et de SARL. La plateforme Data INPI, regroupe les statuts, procès-verbaux d’assemblées générales, comptes annuels non confidentiels, immatriculations, modifications, radiations et les informations relatives aux bénéficiaires effectifs.
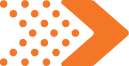
Respecter les obligations de mon entreprise
La Cour de cassation a récemment rendu un arrêt important concernant l’approbation des comptes en dehors du délai légal. Cette décision, rendue le 12 février 2025 (n° 23-86.857), apporte une clarification essentielle sur les obligations des dirigeants d’entreprise en matière de comptabilité et d’assemblée générale.
Dans cette affaire, un gérant de SARL avait été poursuivi et condamné en appel pour abus de biens sociaux et non-soumission des documents comptables à l’assemblée générale dans les délais légaux. Toutefois, la Cour de cassation a partiellement annulé cette décision en rappelant que seule l’absence totale de soumission des comptes à l’AG est punissable, et non un simple retard.
Cette interprétation de l’article L. 241-5 du Code de commerce est cruciale, car elle signifie que le dépassement du délai de six mois après la clôture de l’exercice n’est pas en soi une infraction pénale. En revanche, si les comptes ne sont jamais soumis à l’assemblée générale, le dirigeant s’expose à des sanctions.
Cependant, cette affaire n’est pas totalement close. La Cour de cassation a renvoyé le dossier devant une autre formation de la cour d’appel de Basse-Terre, qui devra rejuger l’affaire en tenant compte de cette nouvelle interprétation.
Cette décision est une avancée pour les dirigeants d’entreprise, car elle limite leur responsabilité en cas de retard dans l’approbation des comptes. Toutefois, il reste impératif de respecter les délais légaux afin d’éviter toute sanction civile ou fiscale.
Le Portail RSE développé par la Direction Générale des Entreprises (DGE) permet aux entreprises de s'informer sur leurs obligations et de s'y conformer, soit directement via la plateforme, soit en étant orientées vers les sites ministériels appropriés.
Pour connaître vos obligations et vous y conformez, consultez le site Portail RSE.
Une entreprise en redressement judiciaire peut éviter la résiliation de son bail pour loyers impayés en réglant sa dette jusqu’au jour où le juge-commissaire statue sur la demande de résiliation.
Lorsqu’une entreprise se trouve en situation de redressement judiciaire et accumule des loyers impayés, le bailleur a le droit de demander la résiliation du bail. Cependant, cette demande ne peut être formulée qu’après un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, et les loyers impayés doivent concerner des périodes postérieures à ce jugement.
> Pour en savoir plus : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 juin 2024, 22-24.177.
Depuis 2017, lorsqu’un salarié conducteur est responsable d’une infraction au Code de la route constatée par radar automatique, celui-ci doit être dénoncé par le représentant légal de la société dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la contravention.
L’oubli d’une telle obligation impose au représentant légal non seulement le paiement d’une amende correspondant à l’infraction, mais également le paiement d’une amende de 4ème classe pouvant atteindre 750€ pour la non-dénonciation.
Mais un tel paiement peut toutefois être évité : en effet, Il a été jugé que le dirigeant d’une société peut contester l’amende qui lui est infligée pour non-dénonciation du conducteur du véhicule en excès de vitesse si, et seulement si, l’avis de contravention ne comporte pas de date d’envoi. En effet, si la date d’envoi n’est pas mentionnée, le délai de 45 jours pour dénoncer l’infraction n’est pas expiré.
Pour aller plus loin : Cassation criminelle, 9 novembre 2021 n°20-8502
Votre entreprise a subi une violation de données (des données personnelles ont été, de manière accidentelle ou illicite, détruites, perdues, altérées, divulguées ou vous avez constaté un accès non autorisé à des données) ?
Vous devez la signalez à la CNIL dans les 72 heures si cette violation est susceptible de représenter un risque pour les droits et libertés des personnes concernées. Cette notification s’effectue en ligne sur le site internet de la CNIL.
Si ces risques sont élevés pour ces personnes, vous devrez les en informer.
Retrouvez en téléchargement le guide de la CNIL concernant la sécurité des données personnelles.
En cas de défaut de dépôt, il existe deux types de sanctions.
>Sanctions civiles :
A la demande de tout intéressé, du ministère public ou de sa propre initiative, le président du tribunal, statuant en référé (autrement dit « en urgence »), peut enjoindre sous astreinte au dirigeant et même à la société (donc à tous les actionnaires/sociétaires qui la composent) de procéder au dépôt des comptes annuels (Cour de cass., com., 3/03/2021, 19-10.086).
A noter : La procédure de demande d’injonction de dépôt ne peut porter que sur les comptes des 5 derniers exercices clos et pas au-delà.
> Sanctions pénales :
Le défaut de dépôt des comptes annuels au tribunal de commerce par les sociétés soumises à cette obligation est sanctionné par une amende pénale de 1 500 euros (article R 247-3 du Code de commerce).
Ce montant est doublé en cas de récidive. Cette amende est à la charge personnelle du représentant légal.
La confidentialité des comptes annuels émise par une SAS peut-elle être demandée après leur dépôt au greffe ?
Non, affirme la Cour d’appel de Paris en rappelant que la déclaration de confidentialité des comptes annuels doit être effectuée au moment du dépôt des comptes au greffe et non après.
Dans les faits une société par actions simplifiée (SAS) saisit le juge commis à la surveillance du Registre du commerce et des sociétés (RCS) d’une demande tendant à rendre confidentiels ses comptes de résultat des exercices 2017, 2020 et 2021.
Pour justifier sa demande, la société par actions simplifiée (SAS) fait valoir qu’elle répond aux critères de petite entreprise et qu’elle peut, à ce titre, prétendre déroger à l’obligation de publication annuelle de ses documents comptables, moyennant la réalisation d’une déclaration de confidentialité.
Le juge saisi rejette ladite demande en rappelant le principe selon lequel la déclaration de confidentialité des comptes annuels doit s’effectuer « lors » du dépôt au greffe de ces comptes, c’est-à-dire au moment du dépôt : le droit à la confidentialité concernant des comptes d’ores et déjà déposés ne peut être accordée.
L’entrepreneur individuel doit disposer d’un statut légal valide (immatriculation au RCS ou au Répertoire des métiers selon l’activité) et, s’il est ressortissant d’un pays hors UE/EEE/Suisse, d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité non salariée (Loi immigration 26 janvier 2024).
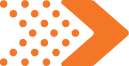
Être Dirigeant de mon entreprise
Dans le cadre d'une société anonyme (SA), la direction générale peut être exercée par le président du conseil d'administration ou par un directeur général nommé par ce dernier. Le choix entre ces deux modes relève de la compétence du conseil d'administration.
Dans un cas récent, le conseil d'administration d'une SA a décidé de transférer les fonctions du directeur général au président, mettant ainsi fin au mandat de ce dernier. L'ancien directeur général a contesté cette décision, affirmant avoir été révoqué sans motif valable et a intenté une action en dommages-intérêts contre la société.
Cependant, les juges ont estimé que cette décision ne constituait pas une révocation abusive. Ils ont souligné que la suppression du poste de directeur général, en confiant ses fonctions au président, n'équivaut pas automatiquement à une révocation. Pour qu'une révocation soit reconnue, il faudrait démontrer que la décision visait à évincer le directeur général de manière injuste.
Dans ce cas précis, le directeur général n'a pas pu prouver que la décision avait pour but de l'évincer ou qu'il avait été révoqué de façon abusive. En effet, son mandat n'a pas été remplacé par un nouveau directeur général, mais plutôt supprimé en raison de la réunion des deux fonctions entre les mains du président du conseil d'administration.
Depuis la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, l’entrepreneur qui débute son activité à titre individuel n’a plus à choisir s’il souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel ou sous le régime de l’EIRL. En effet, depuis cette date, il n’est plus possible d’adopter le statut d’EIRL : ce dernier a disparu au profit d’un statut unique d’Entrepreneur Individuel plus favorable.
L’un des apports majeurs de cette nouvelle législation réside dans la séparation bien distincte des patrimoines de l’entrepreneur. Désormais, les biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel : ce patrimoine ne peut être scindé.
Aussi, les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
Cette distinction de deux patrimoines implique que les créanciers dont les droits naissent de l’activité professionnelle de l’entrepreneur ont les droits sur le seul patrimoine professionnel.
A noter : Il est toutefois précisé que s’agissant de créanciers publics et lorsque des manœuvres frauduleuses et inobservation graves et répétées ont été commises par l’entrepreneur individuel, le recouvrement des sommes dues peut être recherché sur la totalité des biens et droits de l’entrepreneur individuel.
Pour aller plus loin : Article L526-22 à L526-26 du Code de commerce
Pour rappel, depuis le 6 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels. Néanmoins, l’entrepreneur doit effectuer une déclaration d’insaisissabilité de ses biens immobiliers autres que la résidence principale. L’entreprise qui déclare insaisissables ses droits sur une maison lui appartenant avant la cessation de son activité conserve les droits qui découle de cette déclaration.
Ainsi, la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnel du déclarant.
Il résulte de ce principe, précise la cour, que les effets de cette déclaration subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant lui-même. Par conséquent, la cessation de l’activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration.
Dans cette affaire, l’immeuble déclaré insaisissable ne peut donc pas servir à payer les créanciers professionnels de l’entrepreneur dont les droits sont nés après la publication de la déclaration.
Pour aller plus loin : 17 novembre cour de cassation pourvoi n°20-20-821
Dans tous les cas, pour être valable, la délégation devra :
- Être temporaire;
- Ne pourra être totale : il s’agira de déléguer le pouvoir d’accomplir, au nom de la société, un ou plusieurs actes déterminés;
- Être consentie : à un délégataire salarié de la société (ou à un salarié du groupe) qui l’aura acceptée et disposera de la compétence, de l’autorité et des moyens lui permettant d’exercer effectivement les pouvoirs qui lui sont délégués.
Il conviendra, dès lors, de rédiger la délégation de pouvoirs avec rigueur afin de s’assurer de sa parfaite efficacité.
S’il n’est pas rare que l’époux(se) d’un dirigeant ou d’un associé se voie reconnaître la qualité de "dirigeant de fait", encore faut-il qu’il(elle) exerce, en toute indépendance, de réelles attributions de gestion ou de direction au sein de la société.
A titre d'exemple, les juges ont, à plusieurs reprises, considéré que n’était pas un "dirigeant de fait" l’épouse d’un associé qui l’aidait uniquement dans les tâches administratives et qui n’avait à aucun moment assuré la direction générale de l’entreprise ni disposait de la signature bancaire.
Sources : Cass. com. 24-6-2003 n°00-17.700, CA, Paris
Pas systématiquement ! énonce la Cour. En effet, l’article L223-27 du Code de commerce précise que toute assemblée de SARL irrégulièrement convoquée peut être annulée. Il s’agit donc d’une faculté pour les juges saisis d’une demande d’annulation de prononcer la nullité des délibérations de l’assemblée irrégulièrement convoquée.
La Cour de cassation, souhaitant encadrer plus précisément une telle sanction, impose la réunion de deux conditions cumulatives :
- L’associé doit être privé de son droit de participer à l’assemblée générale.
Une telle privation est avérée, par exemple, lorsque l’associé n’a pas été invité à participer à l’assemblée ou lorsque la convocation a été envoyée à une adresse erronée. - L’irrégularité doit avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
La participation aux décisions collectives d’une société par un non-associé est, par exemple, constitutive d’une irrégularité de nature à influer sur le résultat des délibérations (Cass. com. 11-10-2023 no 21-24.646)
Aussi et dans le cas d’espèce, la Cour considère que l’absence de convocation d’un associé détenant 63% du capital de la SARL est nécessairement de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
Un associé engage sa responsabilité en révoquant le dirigeant avec l'intention de lui nuire.
Le gérant d’une SARL peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ou une majorité plus forte si les statuts le prévoient.
Attention toutefois aux motifs de révocation évoqués : la malveillance ou l’intention de nuire au gérant lors de la révocation sera condamnée.
En effet, les juges condamnent, systématiquement, les associés aux dommages et intérêts en raison d’une révocation sans juste motif du gérant et avec l’intention de lui nuire.
Source : Cass.com., 14 mai 2013, n°11-22.845, CA Angers, 17 janvier 2023, n°19/02320.
Dans une SARL comprenant deux associés cogérants, l’associé majoritaire peut révoquer seul le gérant associé minoritaire.
Les statuts d’une SARL composée de deux associés, tous deux cogérants, prévoyaient que les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance devaient être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Les juges ont rappelé que la décision de révocation d’un gérant minoritaire associé d’une SARL, lorsqu’elle ne comporte que deux associés, puisse résulter du seul vote de l’associé possédant plus de la moitié des parts sociales.
La décision de révocation du gérant peut donc valablement être prise par un seul associé dès lors qu’il détient la majorité des parts sociales.
Source : Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 31 mars 2021, 19-12.057
Le gérant ou associé, partie à une convention dite réglementée, est normalement exclu du vote.
Dans cette affaire, l’associé minoritaire d’une SARL avait contesté la décision prise par l’assemblée générale d’attribuer une prime exceptionnelle à l’associé majoritaire au titre de ses fonctions de gérant. En effet, selon lui, cette décision constituait une convention réglementée si bien que l’intéressé n’aurait pas dû prendre part au vote.
Les juges ont estimé que l’octroi d’une prime exceptionnelle au gérant ne s’analyse pas en une convention passée entre ce dernier et la société mais en la fixation d’un élément de sa rémunération. Ce dernier pouvait donc valablement prendre part au vote.
Source : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 31 mars 2021, 19-12.057
Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut pas être considérée comme un abus de majorité, même si elle est contraire à l’intérêt de la société.
Dans le cas spécifique décrit, l’associé majoritaire et l’associé minoritaire ont tous deux approuvé une décision accordant une prime exceptionnelle au gérant avant la cession des actions de la société. Après la cession, le nouveau dirigeant a contesté cette décision, affirmant qu’elle était abusive, mais la Cour a statué que, puisqu’elle avait été approuvée à l’unanimité, elle ne pouvait pas être qualifiée d’abus de majorité.
En résumé, l’unanimité des associés donne une légitimité à une décision même si elle peut sembler défavorable à certains, car cela signifie qu’elle a été acceptée par tous les membres de la société.
Dans le cadre d'une société anonyme (SA), l'augmentation de la rémunération du directeur général (DG) nécessite une décision préalable du conseil d'administration, conformément à la loi. Cette compétence exclusive du conseil d'administration est essentielle, et toute augmentation de rémunération sans son accord peut être considérée comme irrégulière et sujette à une demande de restitution par la société.
Une affaire récente a illustré ce principe : le DG d'une SA avait augmenté unilatéralement sa rémunération pendant son mandat, sans l'accord formel du conseil d'administration. Lorsque la société a demandé la restitution de ces augmentations après le départ du DG, les juges ont confirmé la nécessité de l'accord préalable du conseil d'administration pour toute augmentation de rémunération.
Les arguments selon lesquels ces augmentations n'étaient pas dissimulées administrativement ou comptablement, ou qu'elles étaient cohérentes avec la taille de la société et la rémunération précédente du DG, n'ont pas été considérés pertinents par les juges.
Le dirigeant qui déclare tardivement l’état de cessation des paiements de sa société alors qu’il avait conscience de cet état longtemps à l’avance peut être condamné à une mesure d’interdiction de gérer.
Lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire s’ouvre, le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans un délai de 45 jours expose le dirigeant à des sanctions.
L’omission volontaire de la déclaration de la cessation de paiements dans le délai de 45 jours doit s’apprécier au regard de la date d’ouverture de la procédure. Il convient alors de vérifier que dans les 45 jours qui ont précédé cette ouverture, le chef d’entreprise ne pouvait pas ignorer la cessation des paiements. La confrontation des dates dans cette affaire ne laissait aucun doute sur le caractère tardif de la déclaration, les faits relevés étant très significatifs, un chef d’entreprise ne pouvant ignorer dans de telles circonstances que son entreprise ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le dirigeant avait omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce.
En savoir plus : Cassation commerciale, 12 janvier 2022, n°20-21427, article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce
L’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal (2 mois) ne peut constituer une simple négligence du dirigeant qu’à la condition que celui-ci ait pu ignorer la cessation des paiements.
L’article L. 651-2 du code de commerce permet, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, à un tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, de décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants. Cette sanction est écartée en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société.
La Cour de cassation a estimé que l’omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal constituait une simple négligence.
En savoir plus: Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 février 2021, 19-20.004
Même en tant que dirigeant vous avez le droit d’exercer une action en justice à l’encontre de votre société !
La Cour de cassation a confirmé que l’action en justice d’un dirigeant contre sa société ne peut pas justifier sa révocation.
En effet, le fait qu’un dirigeant ait agi en justice contre la société dans laquelle il exerce des fonctions de dirigeant ne saurait justifier sa révocation pour faute, peu importe que son action ait été déclarée non fondée.
En d’autres termes, le fait qu’un dirigeant poursuive sa société en justice ne constitue pas une faute commise dans ses fonctions et ne peut pas constituer un juste motif de révocation. La Cour de cassation réaffirme par cet arrêt le droit d’agir en justice comme une liberté fondamentale.
En savoir plus: Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875
Lorsqu'un dirigeant a été « flashé » en excès de vitesse dans un véhicule de la société, il doit se désigner expressément comme étant le conducteur. À défaut, la société encourt une amende, au minimum de 450€, au maximum de 750€,
ou 3 000€ en cas de récidive.
L’obligation de dénoncer le conducteur
Lorsqu'une infraction, constatée par un radar, a été commise avec un véhicule de société, son dirigeant doit faire connaître le nom et l'adresse du conducteur. Il a pour cela 45 jours à compter de l’envoi de la contravention.
S’il ne le fait pas, il commet une infraction punie de l’amende prévue pour la contravention de 4e classe (c. route art. L. 121-6).
En pratique, c'est la société qui recevra l'avis de contravention pour cette infraction. L'infraction coûtera 450€ à la société si elle règle dans les 15 jours. Si la société refuse de régler, elle risque d'être condamnée par le tribunal de police. L'amende pourra alors atteindre 750€.
Lorsque le procès-verbal n'est pas complet
Lorsque le procès-verbal de l’infraction de non-désignation n’est pas correctement établi, la société qui s’est abstenue désigner le conducteur ayant commis un excès de vitesse avec l’un de ses véhicules peut échapper au paiement de l’amende encourue à ce titre.
Cass. crim. 9 décembre 2021, n°20-85020
Lorsque le conducteur est le dirigeant
De nombreux contentieux sont apparus lorsque le conducteur était le dirigeant. En effet, tout naturellement, le dirigeant réglait l'amende pour excès de vitesse. Puis, il était désagréablement surpris de recevoir un avis de contravention infligé à la société pour non désignation du conducteur. Pour autant, ce procédé vient d'être clairement validé par la Cour de cassation : si le dirigeant ne se dénonce pas de façon expresse, la société peut se voir infliger l'amende.
Cass. crim. 15 janvier 2019, n° 18-82380
Même en cas d'auto-dénonciation lors de l'audience, le dirigeant sera condamné à payer une amende. En pratique, le dirigeant doit se dénoncer (ou dénoncer le salarié responsable) dès que la société reçoit la première contravention correspondant à l’excès de vitesse. Après, il est trop tard pour faire échapper la société à la sanction pénale.
Cass. Crim. 7 mai 2019, n°18-85729
Location de voiture et paiement des PV
Lorsque le véhicule de location en excès de vitesse est flashé, la société de location échappe à l’amende en indiquant les coordonnées de la société qui a pris le véhicule en location. La société de location n’est pas toujours en mesure de connaître l’identité du conducteur. Ainsi, la Cour de cassation dans sa décision du 1er septembre 2020, admet que la société de location ne paye pas l’amende en indiquant les coordonnées de la société qui a pris le véhicule en location. Le dirigeant de la société devra désigner le conducteur qui a commis l’infraction. A défaut, le dirigeant et sa société encourront l’amende.
Arrêt n°1157 du 1er septembre 2020 (19-85.465)
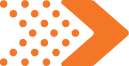
Rédiger, réviser, mettre fin au contrat commercial
Non. Le contrat de propreté ne se transmet pas de droit à l’acquéreur. Le contrat de propreté est transféré seulement si l’acte de cession prévoit ce transfert, que l’acquéreur l’accepte (expressément ou tacitement), et si vous, en tant que prestataire de propreté, acceptez d’exécuter le contrat au profit du nouvel acquéreur.
Que se passe-t-il si le contrat n’est pas transféré ?
Votre client (le vendeur) reste tenu de ses obligations contractuelles envers vous et doit notamment vous indemniser en cas de résiliation anticipée. A défaut, une action pour rupture brutale de vos relations commerciale peut être entamée à son égard.
Comment réparer les préjudices résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies ?
Dans tous les cas, si vous intentez une action en rupture brutale des relations commerciales établies, pensez à produire devant le juge :
- les comptes annuels comprenant les soldes intermédiaires de gestion et les annexes de trois dernières années précédent la rupture,
- les pièces comptables ou autres permettant de calculer le pourcentage du chiffre d’affaires réalisé avec l’auteur de la rupture sur plusieurs années précédant la rupture,
- les pièces comptables ou autres permettant d’identifier les coûts variables et de calculer la marge sur coûts variables de l’activité,
- ainsi que toutes les autres pièces permettant au juge d’apprécier la désorganisation résultant de la brutalité de la rupture.
NB : Si l’action en rupture brutale des relations commerciales établies ne peut être menée à l’encontre d’un syndicat de copropriétaires composé de particuliers, cette action peut tout à fait être introduite lorsque le syndicat de copropriétaires est composé de commerçants. (Cass.com., 28 juin 2023, n° 21-16.940.)
A noter
La règle sur la rupture brutale des relations commerciales ne fait pas obstacle à la possibilité de résilier le contrat sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses propres obligations ou bien en cas de force majeure. Attention toutefois, l’inexécution des obligations doit présenter un caractère de « gravité suffisant » pour justifier la rupture immédiate de la relation commerciale.
En principe, les juridictions veillent à la bonne application des conditions antérieures du contrat pendant toute la période de préavis. Toutefois, le maintien des conditions commerciales antérieures tout au long de la période de préavis peut être particulièrement lourd pour l’entreprise confrontée à des circonstances telles que l’explosion de ses coûts d’approvisionnement, ses coûts de transport, etc.
Aussi, le juge a pu considérer à plusieurs reprises que si les circonstances particulières le justifient et sans que la révision imposée ne soit disproportionnée, les prix peuvent être révisés durant le préavis de résiliation.
Source : Cour d’appel de Paris,
La signature scannée ne suffit pas à prouver de manière fiable le consentement dans les affaires juridiques.
Dans un arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation a abordé la validité de la signature scannée comme preuve de consentement.
Dans cette affaire, une société tentait d’obliger des individus à respecter une promesse unilatérale de vente, mais les signatures scannées n’étaient pas considérées comme fiables par la cour d’appel, décision confirmée par la Cour de cassation.
Cette dernière a souligné que la signature scannée ne peut être comparée une signature électronique en termes de fiabilité, car elle ne permet pas d’identifier clairement l’auteur ni de prouver son consentement aux obligations de l’acte.
Le préavis de résiliation d'une relation commerciale établie ne commence à courir que si la date de la rupture est précisée dans l'acte notifiant l'intention de rompre la relation.
Dans une affaire récente, rendue le 20 mars 2024, une entreprise de transport, en relation d’affaires avec un prestataire informatique depuis près de dix ans, l’informe, fin 2015, qu’il est mis en concurrence avec un autre prestataire informatique.
Fin 2017, l’entreprise de transport rompt le contrat définitivement en s’acquittant d’un paiement de préavis de 3 mois.
Considérant comme insuffisant, le prestataire informatique en place poursuit l’entreprise de transport en paiement de dommages et intérêt pour rupture brutale des relations commerciales établies.
L’entreprise de transport conteste les faits en faisant valoir que le délai de préavis avait couru depuis fin 2015, date à laquelle elle avait manifesté son intention de consulter d’autres prestataires.
La Cour de cassation écarte un tel argument et énonce que le préavis de résiliation ne commence à courir qu'à partir de la notification précise de la date de fin de la relation, et non à partir de l'annonce de la mise en concurrence.
Cette décision confirme des arrêts antérieurs selon lesquels la notification de l'intention de rompre la relation commerciale doit être claire et précise, résultant d’un acte formel : le caractère prévisible de la rupture d’une relation établie ne prive pas celle‑ci de son caractère brutal.
En pratique, pour éviter toute action en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies, il est recommandé de notifier clairement, et par courrier spécifique, au partenaire en place la date prévue de cessation des relations commerciales.
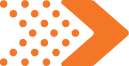
Gérer la fin de mon entreprise
En application de l’article L622-24 du Code de commerce, une déclaration des créances complètes auprès du mandataire judiciaire doit être effectuée par l’entreprise placée en procédure collective.
La déclaration de créances doit comporter l’ensemble des créances existantes, peu importe que la créance soit reconnue ou contestée par l’entreprise concernée. En effet, la Cour de cassation a précisé à plusieurs reprises que, lorsqu’une entreprise en procédure collective déclare une créance, cela ne signifie pas qu’elle en reconnaît le bien-fondé. L’entreprise peut donc toujours contester cette créance par la suite.
A défaut d’une déclaration complète, l’entreprise en procédure collective pourra être financièrement sanctionnée et le créancier évincé sera réintégré au sein de la déclaration des créanciers : Cass.com., 3 juill.2024, n°23-15.715.
Intérêt de la clause de non-concurrence
Lors d'une cession de parts sociales ou d'actions, l'acquéreur peut craindre les agissements concurrentiels du cédant. Cette crainte est particulièrement fondée lorsque le cédant ne part pas à la retraite et ne demeure pas associé ou salarié de la société. C’est la raison pour laquelle, il peut être utile d’inclure dans vos statuts ou actes de cession une clause interdisant au cédant de s'intéresser, à compter de la cession, à toute activité concurrente de votre société et susceptible de nuire aux intérêts de celle-ci.
Une telle clause insérée dans l'acte de cession, par exemple, vous permettra d'obtenir une protection élargie et de limiter les contestations ultérieures sur l'existence ou l'étendue de l'obligation pesant sur le cédant.
Validité de la clause de non-concurrence
Pour être valable, cette dernière doit respecter les conditions cumulatives suivantes :
- la clause doit être explicite et acceptée par les deux parties : cette acceptation se manifeste par la signature du document prévoyant la clause,
- la clause doit être limitée dans le temps et dans l’espace : il faut définir une durée raisonnable d’application ainsi qu’une zone géographique précise,
- la clause doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger : la clause ne doit pas être trop restrictive par rapport aux intérêts qu’elle vise à protéger.
Précisions
Il a été jugé qu’une clause, par laquelle le cédant des actions d’une SAS s’engageait, pour une durée illimitée, à une obligation de totale loyauté à l'égard de la société est valable lorsqu’elle n’implique pas pour le cédant l’interdiction d’exercer toute activité commerciale dans le secteur d’activité de la société : le cédant était donc libre d'entreprendre toute activité commerciale, même en concurrence avec la SAS, dans la mesure où il n'employait pas de moyens déloyaux tels que l'usage de marque contrefaite, l'imitation de marque, la confusion entretenue sur l'identité de l'entreprise, le dénigrement ou toute autre pratique caractérisant la concurrence déloyale (CA Nancy 28/11/2007, n°04-3391 ).
De même, lorsque la cession de parts intervient est liée au départ à la retraite de l’associé, la clause de non-concurrence doit toujours être limitée dans le temps et dans l’espace ainsi qu’être proportionnée à la protection des intérêts de l’entreprise (Cass. 1e civ. 6/10/2011 n°
Exemples ![]()
- Une clause qui prévoit une interdiction pour le cédant des actions d’une société de « créer ou d'exploiter » des activités relevant du même domaine d’activité ou de « s'intéresser directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit » à de telles activités en France métropolitaine est valable en ce qu'elle n'a pas pour effet d’interdire au cédant toute activité professionnelle dans son domaine de compétence pour la durée et le territoire déterminés (CA Paris 8/1/2009 n°
07-21656, 3e ch. B, SA CRC c/ Dugeny). - À la suite de la démission d’un dirigeant d’une grande entreprise, la clause de non-concurrence lui reste applicable dans la mesure où cette dernière est, non seulement, limitée dans le temps et dans l’espace mais également a pour but de protéger les intérêts légitimes de la société (notamment à travers l’interdiction pour le dirigeant démissionnaire de solliciter la même clientèle (Cass. com. 6/10/2015 n° 13-27.41, D. c/ société technique tradition fermeture).
Exemples ![]()
- L’absence de limitation géographie dans la rédaction de la clause de non-concurrence la rend nulle et non avenue. Aussi, a été déclarée nulle la clause de non-concurrence figurant dans les statuts d'une société et prévoyant que « de convention expresse, les associés s'interdisent même après la cession de leurs parts et pendant un délai de cinq années à compter de la cession de participer directement ou indirectement à des activités de nature à concurrencer l'exploitation de la société » (Cass. com. 17/2/1982, Moreau c/ SARL ENGIMO).
- Lors que la clause de la non-concurrence contraint la personne intéressée à une complète reconversion dans un autre secteur d’activité ou à un chômage forcé pendant une longue période, alors cette clause sera considérée comme nulle (CA Paris 6/3/1992).
- Lorsque la clause de non-concurrence est rédigée dans les termes qui portent gravement atteinte à la liberté du commerce alors elle sera considérée comme nulle. C’est ce qui a été jugé par la haute juridiction d’une clause qui avait pour conséquences d’interdire au cédant des parts d’une société spécialisée dans le commerce de gros (donc commerce s’adressant qu’aux professionnels) de ne pouvoir contracter qu’avec des particuliers (Cass. com. 13/12/2011 n°
10-21.653, Sté Tecnicar c/ Tete).
Une fois que l’acte de vente d’un fonds de commerce a été signé, il est impératif de procéder à :
1. L’enregistrement de l’acte de cession auprès de l’administration fiscale et ce dans un délai d’1 mois à compter de la signature de l’acte de cession.
2. La publication de l’acte de cession :
- dans les 15 jours suivant l’acte de cession, l’acquéreur doit faire publier la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
- dans les 15 jours qui suivent la conclusion de l’acte de cession, l’acquéreur doit demander au Tribunal de commerce de procéder à la publication de la vente au Bodacc.
3. La déclaration de l’acte de cession :
- une déclaration auprès CFE ou Guichet unique ;
- une déclaration auprès de l’administration fiscale dans un délai de 45 jours à la suite de la publication de l’acte de cession dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Ce délai est porté à 60 jours pour les personnes assujetties à un régime réel d’imposition, pour les micros-entreprises, pour les auto-entrepreneurs et pour les professions libérales.
Fiscalité de mon entreprise
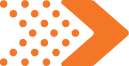
Respecter les obligations comptables et fiscales
Si les CGV ne mentionnent pas de pénalités de retard, le taux applicable est celui du taux de refinancement de la Banque centrale européenne (BCE) majoré de 10 points, soit 14,5% pour le premier semestre 2024.

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) propose aux entreprises de moins de 250 salariés et de moins de 50 millions de chiffre d’affaires annuel, un accompagnement spécialisé.
Cet accompagnement, gratuit et confidentiel en matière fiscale, s'intitule "Accompagnement Fiscal des Petites et Moyennes Entreprises" (AFPME).
L’AFPME, disponible sur tout le territoire, a pour objectif de répondre aux interrogations fiscales des entreprises.
Concrètement, elle offre, à chaque entreprise, un interlocuteur fiscal dédié pour aider notamment à sécuriser les déclarations fiscales.
Ce soutien peut être ponctuel ou régulier, selon les problématiques rencontrées par le dirigeant.
Une erreur comptable intentionnelle peut-elle conduire à un redressement fiscal même en l’absence d’incidence sur l’actif net de l’entreprise ?
Dans une affaire récente examinée par le Conseil d'État, une entreprise avait commis une erreur comptable délibérée en inscrivant une dette au passif au nom d'un associé, alors que cette dette n'avait pas réellement été générée par cet associé. Pour donner suite à une vérification fiscale, l'administration a réintégré cette dette au bénéfice de l'entreprise, accompagnée de pénalités pour manquement délibéré.
La société a plaidé que cette erreur n'avait pas eu d'impact sur son actif net et a contesté le redressement fiscal. Cependant, le Conseil d'État a pris une décision importante : une erreur comptable délibérée peut justifier un redressement fiscal même en l'absence d'incidence directe sur l'actif net de l'entreprise.
Le juge a argumenté que le fait de ne pas enregistrer délibérément une dette au passif, même si elle n'a pas affecté l'actif net, ne peut être considéré comme une simple erreur de bonne foi. Il a souligné que cette omission intentionnelle sur plusieurs exercices ne peut être tolérée et justifie un redressement fiscal avec des pénalités.
Ainsi, cette décision met en lumière l'importance de la rigueur dans la comptabilité des entreprises et la responsabilité des contribuables en matière de déclarations fiscales, même en l'absence d'incidence directe sur leur situation financière globale.
Les PME peuvent bénéficier d'un taux d'impôt sur les sociétés (IS) plus faible, à condition de respecter certains critères, tels qu'un capital détenu à 75% par des personnes physiques, un capital social intégralement libéré et un chiffre d'affaires hors taxes ne dépassant pas 10 millions €. Depuis plus de 20 ans, ce taux d'IS est de 15% pour un bénéfice plafonné à 38.120 €. Toutefois, en 2023, le plafond a été augmenté à 42.500 €, permettant ainsi aux PME de réaliser des économies supplémentaires. La tendance à la baisse de l’impôt sur les sociétés a atteint un taux de droit commun de 25% depuis 2022, sans modification pour l’année 2024.
Pour bénéficier du taux d’impôt sur les sociétés (IS) à 15%, les petites et moyennes entreprises (PME) doivent remplir certains critères. Tout d'abord, leur capital doit être détenu au moins à 75% par des personnes physiques ou par une société détenue au moins à 75% par des personnes physiques. Ensuite, leur capital social doit être intégralement libéré, et leur chiffre d’affaires hors taxes ne doit pas dépasser 10 millions €.
Depuis plus de 20 ans, les PME peuvent bénéficier d'un taux d’IS à 15% pour les bénéfices qui ne dépassent pas 38 120 €. Cependant, la quote-part de bénéfice excédant ce seuil est soumise au taux d’impôt normal de 25% depuis les exercices ouverts au 1er janvier 2022.
L'article 37 de la loi de finances pour 2023 a modifié le plafond de bénéfice imposable au taux de 15%. Le nouveau plafond est désormais de 42 500 €, ce qui représente une augmentation de plus de 10% par rapport à l'ancien plafond. Cette mesure permet aux PME de bénéficier d'une économie pouvant dépasser 400 €. Pour que cette mesure soit applicable, les PME doivent remplir les critères mentionnés ci-dessus.
Le nouveau seuil de 42 500 € est applicable dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, soit le 31 décembre 2022.
Créé par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, l'examen de conformité fiscale permet à toutes les entreprises, quels que soient leur chiffre d’affaires et leur régime d’imposition, de confier à un prestataire un contrôle préventif sous la forme d’un audit. Ce prestataire peut être un commissaire aux comptes, un expert-comptable, un avocat, une association de gestion et de comptabilité ou un organisme de gestion agréé.
L’Examen de Conformité Fiscale (ECF) permet à un professionnel de valider des points de l’organisation comptable et fiscale d’une entreprise selon une procédure bien définie. Il a pour finalité d'éviter et éventuellement de réparer les erreurs fiscales en amont de tout contrôle fiscal.
L’émission d’une déclaration précise que l’entreprise auditée respecte dix points de contrôle précis. Cet examen est annuel.
Pour en savoir plus : La circulaire - FEP
Pour ce qui est de la conservation de ces factures, les factures dématérialisées et transmises par voie électronique doivent être conservées dans les délais et conditions prévus par l’article L. 102B du Livre des procédures fiscales, c’est-à-dire :
- sur support informatique pendant une durée au moins égale au délai du droit de reprise prévu à l’article L. 169 du Livre de procédures fiscales, soit trois ans ,
- sur tout support au choix de l’entreprise pendant les trois années suivantes.
A NOTER
Durant les 3 premières années, les factures dématérialisées doivent être conservées dans leur format informatique original, c’est-à-dire celui dans lequel elles ont été émises : le changement de format informatique des factures n’offre pas la garantie nécessaire (Article 289, V du Code général des impôts).
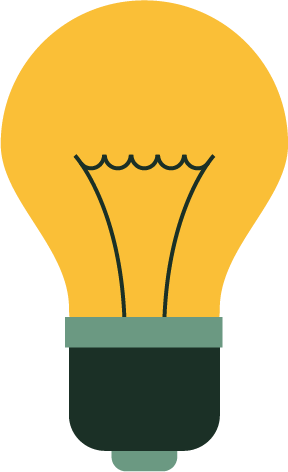
Dans le domaine fiscal, les entreprises peuvent être confrontées à différents types de contrôles, tels que la vérification de comptabilité et le contrôle sur pièces. La vérification de comptabilité est une procédure approfondie qui examine en détail tous les aspects comptables de l'entreprise sur une période donnée, tandis que le contrôle sur pièces est plus léger et se concentre sur des éléments spécifiques sans passer en revue l'intégralité des comptes.
La règle de base est que l'administration fiscale ne peut pas initier une nouvelle vérification de comptabilité pour les mêmes impôts et la même période une fois que la première a été réalisée, sauf exceptions prévues par la loi. Cependant, elle est autorisée à mener un contrôle sur pièces pour corriger des erreurs ou des insuffisances découvertes lors de la vérification de comptabilité, pourvu que ce contrôle concerne les mêmes impôts et la même période que la vérification précédente.
Un exemple récent illustre cette situation : une entreprise a été soumise à une vérification de comptabilité en 2015, suivie d'un contrôle sur pièces en 2016 portant sur les mêmes impôts et la même période. Bien que l'entreprise ait contesté ce contrôle en invoquant la garantie du non-renouvellement de la vérification, le Conseil d'État a confirmé la légalité de cette pratique, soulignant que seule la succession de deux vérifications de comptabilité est interdite.
L’entreprise a reçu un avis de vérification de comptabilité. Puis-je demander à changer la date prévue pour la première visite du vérificateur dans nos locaux ?
Vous pouvez tout à fait solliciter le report de cette intervention en formulant rapidement une demande par écrit à l’administration fiscale. Cette dernière n’est toutefois pas obligée de l’accepter.
Cette demande ne sera accueillie favorablement que si les raisons que vous invoquez paraissent sérieuses : Par exemple, si votre comptable est absent ou que votre entreprise est fermée pour cause de congés.
Généralement, l’administration vous informe de la nouvelle date retenue par pli recommandé avec avis de réception, et non par un autre avis de vérification.
Les entreprises peuvent être amenées à offrir des cadeaux à leurs clients et à leurs salariés. Ces opérations obéissent à un régime fiscal particulier dont le respect fait l'objet d'une stricte surveillance de la part de l'administration fiscale.
Sont considérés comme cadeaux, les objets publicitaires (stylos, porte-clefs), les échantillons de produits ou ceux faits pour remercier les clients fidèles (panier garni, chocolats). Sont exclus les dépenses et cadeaux liés à la chasse et à la pêche.
Récupération de la TVA
Peu importe le bénéficiaire , la TVA supportée sur les cadeaux n’est normalement pas déductible sauf s’il s’agit de biens de très faibles valeurs. Une entreprise peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsque le prix de revient ou d'achat du cadeau offert est de 73€ depuis le 1er janvier 2021, par objet et par bénéficiaire (clients, fournisseurs, salariés, …) (CGI, ann. IV art.28-00 A). L’administration inclut dans cette valeur tous les frais annexes éventuels, c'est-à-dire les frais de port, d'emballages,…Si au cours de l’année, l’entreprise offre plusieurs cadeaux à un même client, c’est la valeur totale de ceux-ci qui ne doit pas excéder 73€ depuis le 1er janvier 2021.
Déductibilité du résultat
Les cadeaux faits par l’entreprise constituent une dépense déductible du résultat (donc de l'impôt sur les sociétés) dès lors qu’ils sont faits dans l'intérêt direct de l'entreprise, qu’ils aient une cause licite et que leur valeur n'est pas excessive (BOI-BIC-CHG-40-20-40-20160830 -§§ 250 à 270). L’appréciation du caractère exagéré résulte des circonstances de fait propres à chaque entreprise. Outre les usages existant dans la profession, la taille de l’entreprise, son activité et son développement sont pris en considération. Lorsque l’intérêt direct de l’entreprise ne peut être prouvé, cette condition suffit à elle seule à justifier la réintégration par l’administration fiscale des dépenses dans le résultat imposable dans l’entreprise, indépendamment du caractère ou non excessif des cadeaux d’affaires concernés.
Lorsque le montant total des cadeaux dépasse 3 000€ par exercice, il doit être mentionné obligatoirement sur le relevé des frais généraux. C’est le relevé spécial (2067) à joindre à la déclaration des résultats, s’’il s’agit d’une société et quel que soit son régime fiscal ou dans le cadre spécial de l’annexe 2031 bis à leur déclaration de résultats pour les entreprises individuelles.
La mention obligatoire sur le relevé des frais généraux ne concernent pas les objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur n’excède pas 73€ depuis le 1er janvier 2021 par bénéficiaire (CGI, ann. IV art. 4J). Ces objets doivent comporter une inscription apparente et indélébile (BOI-BIC-CHG-40-60-10-20170301-§§ 110). Ils ne sont pas à prendre pour apprécier la limite de 3000€. Lorsque leur montant global n’atteint pas la limite de 3 000 €, les cadeaux n’ont pas à figurer sur le relevé des frais généraux, l’obligation de fournir ce relevé ne s’appliquant qu’aux seules catégories de frais pour lesquels les seuils sont dépassés (CE 15 avril 1991, n° 76578, CE 12 janvier 1983, n°24530).
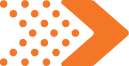
Faire face aux contrôles et au contentieux fiscal
Avec la numérisation des services publics, l’administration fiscale a la possibilité d’envoyer une proposition de redressement par courriel. Mais sous quelles conditions cette méthode est-elle valide et sécurisée ?
Le recours au courriel pour une notification fiscale
Traditionnellement, une proposition de redressement fiscal est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) pour garantir la preuve de l’envoi et de la réception. Cependant, le Conseil d’État a récemment confirmé que l’administration fiscale n’est pas obligée d’utiliser exclusivement la LRAR. Elle peut recourir à d’autres moyens, comme le courriel, à condition de fournir des preuves offrant des garanties équivalentes à celles de la LRAR.
L’exemple avec l’application Escale
Dans une affaire récente, une proposition de redressement fiscal a été envoyée à un contribuable via un courriel contenant un lien vers « Escale », une application sécurisée utilisée par l’administration fiscale pour échanger des documents. Cette méthode a été contestée par le contribuable, mais la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que la preuve apportée par l’administration était suffisante. En effet, l’administration avait fourni une capture d’écran indiquant la date et l’heure de téléchargement du fichier par le contribuable. Pour les juges, cette méthode garantissait une traçabilité et une confidentialité équivalentes à celles d’un envoi par LRAR.
Une nouvelle règle simplifie la contestation des décisions fiscales : l’envoi postal avant la date limite suffit, même si la réception est tardive.
Pour contester une décision fiscale, par exemple après le rejet d’une réclamation, un contribuable a généralement deux mois pour déposer sa demande au tribunal administratif. Auparavant, la demande devait être reçue par le tribunal avant la fin de ce délai, à moins d’un retard dû aux services postaux. Une demande reçue après la date limite était donc rejetée.
Le Conseil d’État a modifié cette règle : désormais, c’est la date d’envoi de la demande qui est prise en compte, pas celle de réception. Ainsi, une demande postée le dernier jour du délai est valide, peu importe sa date de réception.
Cependant, cette règle ne s’applique pas aux appels devant les cours administratives d’appel ou les pourvois devant le Conseil d’État, qui doivent être effectués électroniquement via « Télérecours ».
Le délai pour que l’administration fiscale puisse rectifier les droits d’enregistrement commence à la date de dépôt de l’acte, accompagnée du paiement des droits, et non pas à celle de son enregistrement effectif.
Les droits d’enregistrement sont des taxes exigées lors de la formalisation d’actes juridiques, comme les ventes immobilières ou les cessions de parts sociales, ce qui concerne fréquemment les entreprises. Lorsqu’un acte est présenté pour enregistrement avec paiement des droits, l’administration fiscale dispose d’un délai pour corriger des erreurs éventuelles, appelé « droit de reprise ». Ce délai permet à l’administration d’intervenir jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle où les droits ont été révélés par l’enregistrement.
Une affaire a mis en lumière cette problématique. Un acte de donation de la nue-propriété d’un bien immobilier a été déposé le 31 décembre 2010, avec paiement des droits de mutation, et enregistré le 4 janvier 2011. Le 12 décembre 2014, l’administration fiscale a adressé un redressement aux donataires, basé sur une réévaluation du bien. Les donataires ont contesté ce redressement, arguant que l’administration avait dépassé le délai imparti. Selon les donataires, le délai de reprise aurait dû commencer à la date de dépôt de l’acte, soit le 31 décembre 2010, et expirer le 31 décembre 2013. Par conséquent, le redressement du 12 décembre 2014 était hors délai.
La Cour de cassation a confirmé cette analyse. Elle a jugé que, lorsque les droits sont payés le jour du dépôt d’un acte et que l’enregistrement est accepté par le comptable, l’acte est considéré comme enregistré à la date de son dépôt. Ainsi, le délai de reprise commence à cette date et non à la date de l’enregistrement effectif.
> Pour en savoir plus : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 mai 2024, 22-18.929
Même si l’administration fiscale ne mentionne pas la possibilité de saisir la commission des impôts, le contribuable conserve ce droit en cas de désaccord sur un redressement.
En cas de désaccord avec un redressement fiscal, un contribuable peut saisir la commission des impôts, même si l’administration ne le mentionne pas explicitement. Cette omission ne prive pas le contribuable de ce droit. Il dispose de 30 jours après la réponse de l’administration rejetant ses arguments pour faire cette demande.
Récemment, une société a contesté un redressement fiscal en arguant que l’administration avait omis de mentionner cette possibilité. Le Conseil d’État a jugé que cette omission n’annule pas le redressement. Ainsi, le droit de saisir la commission reste valable même sans mention explicite.
> Pour en savoir plus : Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/06/2024, 472077.
Si vous rencontrez un problème avec l’administration fiscale (contrôle fiscal, problèmes de déclaration, de calcul ou de paiement de l’impôt), vous pouvez utiliser les voies de recours amiables en saisissant le conciliateur fiscal départemental. Le conciliateur peut apporter une solution amiable dans les domaines suivants :
- des problèmes fiscaux ou un différend avec l’administration fiscale ou le Trésor public : rejet ou admission partielle d’une réclamation, rejet d’une demande gracieuse de remise de pénalités, refus de délais de paiement par exemple,
- des litiges relatifs aux engagements de qualité de service pris par l’administration fiscale.
Pour le saisir, une première démarche auprès des services des impôts est obligatoire, au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception de réception exposant l’objet du problème ou du litige, éventuellement accompagnée de l’avis d’imposition incriminé. Si à l’issue de cette première démarche, l’entreprise estime que sa demande n’a pas été examinée de façon satisfaisante, elle peut alors s’adresser au conciliateur par courriel ou par courrier.
Son délai de réponse est en principe de 30 jours pour informer soit de sa décision, soit de l’état du traitement de la demande pour les dossiers plus complexes. La saisine du conciliateur ne dispense pas du paiement des sommes réclamées et n’interrompt pas les délais de recours contentieux. Il est possible de demander un sursis de paiement dans le courrier adressé au service des impôts.
Pour contacter le conseiller fiscal de votre département, cliquez sur le lien
Attention à vos déclarations fiscales : les sanctions pourront être publiées !
Inédit : l’administration fiscale publie, pour la première fois depuis la mise en place du dispositif permettant les publications de sanctions fiscales, une sanction administrative prononcée à l’égard d’une société de sécurité qui a commis des actes frauduleux.
Le but de cette publication étant de dissuader les entreprises à commettre des actes frauduleux en matière fiscale.
La publication est visible sur le site internet de l’administration fiscale pendant une durée maximum d’un an.
Source : Sanctions administratives appliquées à la suite d'un contrôle fiscal | impots.gouv.fr
Dans le contexte d'une Société par Actions Simplifiée (SAS), les membres du conseil de surveillance, lorsque leurs fonctions s'apparentent à celles de dirigeants, se retrouvent dans l'obligation d'être affiliés au régime général de la Sécurité sociale et de régler des cotisations sociales sur leurs rémunérations.
Traditionnellement, les dirigeants de sociétés, tels que les gérants minoritaires de SARL ou les présidents de SAS, sont considérés comme des "dirigeants assimilés salariés", entraînant leur affiliation au régime général de la Sécurité sociale et le paiement de cotisations sociales sur leurs revenus. Cependant, cette règle connaît des nuances dans le cas des membres du conseil de surveillance d'une SAS. En principe, ils ne sont pas soumis à cette affiliation ni aux cotisations sociales, à moins qu'ils n'exercent effectivement des fonctions de direction au sein de l'entreprise.
Une affaire récente a illustré cette distinction : une SAS s'est vu notifier un redressement de cotisations sociales pour les rémunérations versées au président et au vice-président de son conseil de surveillance. Contestant cette décision, la SAS a argué que ses membres de conseil n'étaient pas des dirigeants au sens strict et n'étaient donc pas soumis à ces cotisations.
Cependant, la Cour d'appel de Paris a tranché en faveur du redressement, soulignant que les membres du conseil de surveillance assumaient des responsabilités de direction. Par exemple, le président du conseil de surveillance était un ancien PDG de la société, et ses pouvoirs étaient substantiels, limitant ainsi le conseil de direction dans ses actions. La Cour de cassation a confirmé cette décision, considérant que ces membres du conseil avaient bien la qualité de dirigeants et devaient donc payer les cotisations sociales correspondantes.
Le contribuable a la possibilité de demander la saisine de l'interlocuteur départemental immédiatement après son entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, sans avoir à attendre une prise de position officielle de ce dernier.
Lors d'un contrôle fiscal, un contribuable qui conteste le redressement envisagé peut solliciter un entretien avec les supérieurs hiérarchiques du vérificateur. En cas de désaccord persistant, il peut faire appel à l'interlocuteur départemental avant la mise en recouvrement du redressement. Ce double recours hiérarchique est un droit garanti par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
Cependant, dans une affaire récente, une société avait demandé l'annulation d'un redressement faute d'avoir pu saisir l'interlocuteur départemental dans les délais impartis. En effet, la société avait rencontré le supérieur hiérarchique du vérificateur le 28 novembre 2017, mais n'avait reçu la confirmation du redressement qu'après le délai légal pour solliciter l'interlocuteur départemental.
Le Conseil d'État a toutefois estimé que le supérieur hiérarchique n'était pas tenu de prendre une position formelle à l'issue de l'entretien avec le contribuable. Par conséquent, en l'absence de réponse, le désaccord avec l'administration fiscale est présumé persister. Ainsi, la société aurait pu demander la saisine de l'interlocuteur départemental dès la fin de son entretien avec le supérieur hiérarchique. Dans cette affaire, elle a bénéficié d'un délai raisonnable de 17 jours pour faire appel à l'interlocuteur départemental, avant la mise en recouvrement du redressement.
Il est donc important pour les contribuables de savoir qu'ils peuvent demander la saisine de l'interlocuteur départemental dès la fin de leur entretien avec le supérieur hiérarchique, sans attendre une position formelle de ce dernier. Cela leur évitera tout risque de délai et garantira ainsi leur droit à un double recours hiérarchique en cas de désaccord avec l'administration fiscale.
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un contrôle fiscal et souhaite contester le redressement proposé par l'administration fiscale, elle peut adresser une réclamation. Toutefois, il est important de respecter les délais impartis.
En principe, la réclamation doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la 3ème année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification. Il est également essentiel de noter que la réclamation peut porter sur les impositions supplémentaires établies à la suite de la proposition de rectification ainsi que sur les impositions initiales visées par la procédure.
La question peut se poser de savoir si une réclamation postée le jour de l'expiration du délai imparti et reçue postérieurement par les services fiscaux est valable. Le Conseil d'État a récemment tranché cette question en faveur du contribuable. En effet, le respect du délai s'apprécie par rapport à la date d'envoi de la réclamation et non par rapport à sa date de réception par l'administration. Ainsi, une réclamation peut être valablement envoyée jusqu'au dernier jour de la date limite. Par exemple, une réclamation formulée pour contester une proposition de rectification notifiée en 2020 peut être postée au plus tard le 31 décembre 2023, peu importe qu'elle soit réceptionnée ultérieurement par l'administration.
Il est cependant fortement recommandé d'envoyer une réclamation fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de pouvoir prouver sa date d'envoi. En effet, le cachet de la Poste faisant foi, cela permettra au contribuable de s'assurer que sa réclamation a bien été envoyée dans les délais impartis.
Le défaut de remise d’une comptabilité informatisée lors d’un contrôle fiscal est sanctionné par une amende dont les modalités de mise en œuvre ont été récemment précisées par l’administration fiscale.
Lorsque l’entreprise tient une comptabilité informatisée et qu’elle fait l’objet d’une vérification ou d’un examen de comptabilité, elle doit remettre à l’administration fiscale une copie des fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée, dès le début des opérations de contrôle. Le défaut de présentation du FEC ou la remise de fichiers non conformes aux normes requises peut être sanctionné par une amende de 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge de l’entreprise. Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait que l’amende était applicable pour chaque exercice soumis au contrôle pour lequel la copie du FEC n’avait pas été remise au vérificateur ou n’était pas conforme aux normes requises. Suivant la position de la Cour administrative d’appel de Lyon, l’administration fiscale considère désormais que l’amende n’est applicable qu’une seule fois par contrôle, quel que soit le nombre d’exercices contrôlés.
Pour en savoir plus : BOI-CF-IOR-60-40-10 du 15 décembre 2021, n° 290
L’inaction d'une entreprise sur une brève période peut constituer une opposition au contrôle fiscal, entraînant une imposition d'office. Les juges ont récemment confirmé cette notion.
Dans un cas récent, une SARL avait demandé le report d'un contrôle fiscal en raison de l'absence de comptabilité pour 2013. Malgré une période de seulement 10 jours entre deux correspondances du fisc, les juges ont validé l'imposition d'office pour opposition au contrôle fiscal, assortie d'une majoration de 100 %.
TVA
Les interventions directement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne (aide à la toilette, à l’habillage, aux repas, etc.) des personnes handicapées ou âgées et dépendantes sont soumises au taux réduit de 5,5%.
L’entretien courant du logement et les travaux ménagers sont soumis au taux réduit de 10 %, même lorsqu’ils sont réalisés chez une personne fragile ou financés par un organisme tiers (CAF, mutuelle, conseil départemental).
L’administration fiscale a récemment précisé les modalités de régularisation de la TVA facturée à tort, en tenant compte de jurisprudences européennes et nationales. Cette clarification vise à encadrer les démarches des entreprises confrontées à ce type d’erreur, tout en fixant des conditions strictes pour corriger la situation.
La régularisation de la TVA facturée à tort est possible sous plusieurs conditions précises :
- Existence d’un fait nouveau
Un redressement fiscal du client constitue un élément nouveau permettant au fournisseur de prolonger le délai de réclamation et de rectifier les factures concernées. Cela ouvre la possibilité d’une régularisation de la déduction opérée par le client. - Procédure de remboursement
- le client doit, en premier lieu, demander le remboursement de la TVA indue au fournisseur,
- l’intervention de l’administration fiscale n’est possible qu’en cas d’impossibilité avérée de remboursement par le fournisseur, notamment en cas de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité.
Source : BOFiP
Le remboursement du crédit de TVA dépend du régime d’imposition de l’entreprise.
- Pour les entreprises soumises au régime réel normal d’imposition à la TVA et qui effectuent mensuellement ou trimestriellement une déclaration de TVA, elles peuvent demander le remboursement si le crédit excède 760€. Celles dont le montant de TVA exigible pendant l’année est inférieur à 15 000 € et qui établissent leur déclaration de TVA annuellement peuvent demander le remboursement pour un minimum de 150 €.
- Pour les entreprises soumises au régime réel simplifié d’imposition, elles peuvent demander le remboursement si le crédit atteint le seuil minimum de 150 €. Elles peuvent aussi demander le remboursement lorsqu’elles versent l’un des deux acomptes semestriels de TVA, mais la demande doit être au moins de 760 € et la TVA remboursée doit provenir de l’achat de biens immobilisés. Dans ce cas, des factures doivent être fournies pour justifier la demande.
Lorsqu’une entreprise paie plus de TVA qu’elle n’en doit, elle peut obtenir « un crédit de TVA ». Elle peut alors utiliser ce crédit de deux manières : soit en le gardant pour les périodes fiscales suivantes, soit en demandant à être remboursée de tout ou partie du crédit mais cela dépend de certains seuils.
Si votre entreprise est nouvelle et que vous n’avez pas encore vendu ou réalisé des prestations ou facturé de la TVA, vous pouvez également demander le remboursement de TVA que vous avez payée sur les achats engagés pour le lancement de votre activité. Les micro-entreprises ont une option différente. Si leur chiffre d’affaires ne dépasse pas un certain seuil, elles peuvent ne pas avoir à payer de TVA sur les ventes ou les prestations réalisées. Mais dans ce cas, elles ne peuvent donc pas déduire la TVA payée sur leurs achats réalisés dans le cadre de leur activité professionnelle.
Pour demander le remboursement de crédit de TVA, les entreprises peuvent utiliser deux moyens différents selon le mode de télédéclaration et de télépaiement utilisé.
Si elles ont recours au mode EDI, c’est l’expert-comptable qui transmettre les fichiers de demande de remboursement de crédit de TVA, tandis que si elles ont recours au mode EFI, la demande de remboursement de TVA est accessible dans l’espace professionnel à partir de la rubrique « mes services ». Il faudra alors choisir l’option « effectuez une demande de remboursement de crédit de TVA » en indiquant la période de référence et en sélectionnant le formulaire correspondant.
Pour en savoir plus, vous avez la possibilité de visionner le tutoriel pour effectuer une demande de remboursement de TVA réalisé par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).
Qu’est-ce que l’autoliquidation ?
L’autoliquidation de la TVA est un nouveau dispositif qui s’impose aux entrepreneurs du bâtiment depuis la loi de finances pour 2014. En effet, depuis le 1er janvier 2014, un mécanisme d'autoliquidation de la TVA est instauré dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le compte d'un donneur d'ordre assujetti à la TVA. Ainsi, la taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant doit désormais être acquittée par le donneur d'ordre. Les sous-traitants n'ont plus à déclarer ni à payer la TVA due au titre de ces opérations.
Pour rappel
La sous-traitance est définie comme une opération par laquelle un entrepreneur confie par un contrat (dit « le sous-traité»), et sous sa responsabilité, à un prestataire sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître d'ouvrage. Le sous-traitant agit toujours pour le compte d'une entreprise principale.
Les entreprises de propreté sont-elles concernées ?
Le BOI-TVA-DECLA-10-10-20 stipule que « les opérations de nettoyage qui sont le prolongement ou l'accessoire des travaux visés ci-dessus sont soumises au même régime que ces travaux. Seules les opérations de nettoyage faisant l'objet d'un contrat de sous-traitance séparé sont exclues du dispositif d'autoliquidation ». Voici quelques exemples qui illustrent ces propos :
- Cas N° 1 : « Je suis une entreprise de propreté et j’interviens directement auprès d’un client : Exclusion du dispositif d’autoliquidation.
- Cas N° 2 : « Je suis entreprise de bâtiment et je réalise des prestations de nettoyage : Autoliquidation.
- Cas N° 3 : « Je suis une entreprise de propreté et je soustraite les prestations de propreté par une autre entreprise de propreté : Exclusion du dispositif d’autoliquidation
- Cas N° 4 : « Je suis une entreprise de propreté et l’entreprise principale de bâtiment ou travaux public me sous-traite les prestations de propreté » (les opérations de nettoyage qui sont le prolongement ou l'accessoire des travaux) : Autoliquidation.
Comment s’applique l’autoliquidation ?
Pour le sous-traitant, il doit adresser au pouvoir adjudicateur sa demande de paiement avec l’original de la facture libellée au nom de l’entreprise principale en montant HT du marché sans faire apparaître de TVA mais avec la mention
« autoliquidation ».
Quel organisme doit-on contacter en matière de TVA ?
Seul le centre des impôts du lieu de votre siège social est habilité à vous confirmer l’application de la TVA.
Pour en savoir plus : entreprendre.service-public.fr, Code général des impôts, article 283.
Selon l'article 283 du Code général des impôts, les prestations de nettoyage de fin de chantier effectuées par une entreprise sous-traitante pour le compte d'un preneur assujetti ne sont pas soumises à la TVA.
Cela s'applique également aux travaux de construction, de réparation, d'entretien, de transformation et de démolition effectués par une entreprise sous-traitante. Cette exemption s'applique aux prestations effectuées dans le prolongement de travaux de construction de biens immobiliers. Les factures émises par la société sous-traitante ne doivent pas mentionner la TVA. Cependant, l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance au maître de l'ouvrage sur demande. Si aucun contrat de sous-traitance n'est conclu, cela peut entraîner des conséquences importantes sur le plan fiscal en ce qui concerne la TVA applicable.
Source : CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 01/12/2022, 20TL04836


Lorsque l’administration fiscale envoie une proposition de redressement fiscal, elle utilise l’adresse que vous avez communiquée au moment de l’envoi.
Si vous signalez un changement d’adresse après l’envoi de l’avis, l’administration utilisera l’ancienne adresse. Cependant, s’ils se croisent, l’administration renverra l’avis à la nouvelle adresse, à moins que vous n’ayez déjà été informé à temps.
> Pour aller plus loin : Conseil d'Etat, 12 juillet 2023 n°465351